La dette (rançon) de l'indépendance : devoir de mémoire et vérité historique
La rançon de l’indépendance souvent appelée à tort « dette de l’indépendance » représente une véritable outrage infligée à la jeune République d’Haïti au lendemain de sa victoire historique. Arrachée de hautes luttes, l’indépendance haïtienne fut le fruit de sacrifices immenses consentis par d’anciens esclaves, jadis piliers de la prospérité de la colonie la plus florissante de l’empire français. Cette exigence de compensation par l’ancienne métropole, imposée sous la menace, marqua le début d’un long cycle d’iniquités économiques et politiques. Pour en saisir toute la portée, il convient d’analyser cette injustice à travers plusieurs prismes : le contexte historique qui l’a vu naître, les dynamiques économiques qui l’ont nourrie, les enjeux politiques qu’elle a engendrés, et les répercussions postmodernes qu’elle continue de susciter.
Au lendemain de la guerre de l'indépendance, menée de hautes luttes par les pères fondateurs , Jean-Jacques Dessalines, Henry Christophe, Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, pour ne citer que ceux-là – la jeune République d’Haïti se retrouve confrontée à un contexte international hostile, encore largement dominé par le système esclavagiste. En Amérique du Nord, les États-Unis, bien qu’indépendants de la Couronne britannique, maintiennent l’esclavage. En Amérique latine, la servitude bat encore son plein au profit des royaumes ibériques, notamment l’Espagne et le Portugal.
L’indépendance haïtienne, arrachée en 1804 par des esclaves affranchis devenus soldats et stratèges, fut une gifle infligée à l’ordre mondial établi. Conscient de cet isolement diplomatique, Dessalines prend des mesures drastiques : fortifie le pays, applique une politique de “rassia” pour éradiquer les vestiges du colonialisme, et mène la campagne de l’Est – une diplomatie préventive contre un éventuel retour des puissances coloniales.
Malheureusement, les luttes intestines et les rivalités entre chefs vont causer la mort de l’Empereur. Trois ans après l’indépendance, le pays se divise en plusieurs entités : le Nord et l’Artibonite sous Henry Christophe, l’Ouest sous Alexandre Pétion, le Sud brièvement sous André Rigaud puis Gérin, avant d’être rattaché à l’Ouest. Le pays est alors plongé dans des années de conflits fratricides entre Pétion et Christophe. Après la mort de Pétion en 1818 et le suicide de Christophe en 1820, Jean-Pierre Boyer réunifie le pays, seize ans après l’indépendance.
Sur le plan international, un tournant s’opère : en 1815, Napoléon est définitivement vaincu à Waterloo et exilé à Sainte-Hélène. La monarchie est restaurée en France avec le retour des Bourbons sous Louis XVIII. Les anciens colons, soutenus par une classe politique nostalgique de l’ordre colonial, exercent une pression croissante pour obtenir une indemnisation pour leurs “pertes” liées à l’indépendance haïtienne.
Avec l’arrivée au pouvoir de Charles X, roi ultra-royaliste, l’injustice prend une tournure officielle : le 17 avril 1825, il signe une ordonnance exigeant une rançon de 150 millions de francs-or, soit dix fois le PIB haïtien de l’époque, en échange de la reconnaissance de l’indépendance. Sous la menace d’une flotte de guerre stationnée dans la rade de Port-au-Prince, Haïti est contrainte de signer , un acte de diplomatie de la canonnière.
Le montant sera ensuite réduit à 90 millions, mais les conditions demeurent étouffantes : avantages commerciaux accordés à la France, et un prêt imposé auprès de banques françaises, qui place le pays dans un cycle de dette dont il ne sortira qu’en 1947. Pendant 125 ans, le paiement de cette rançon va hypothéquer tout développement durable, empêcher l’émergence d’une industrie nationale et exclure Haïti de la révolution industrielle du XIXe siècle. L’État, accaparé par le service de la dette, ne peut subvenir aux besoins de ses citoyens, et la paysannerie haïtienne, colonne vertébrale de la production agricole, est la principale victime de cette injustice.
D’un point de vue post-moderne, l’ordonnance de Charles X fête tristement ses 200 ans cette année. En 2004, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance, le président Jean-Bertrand Aristide a officiellement réclamé restitution et réparations, dénonçant un braquage impérialiste orchestré par une nation qui se réclame pourtant des droits de l’homme. La France, qui par la loi Taubira (2001) reconnaît l’esclavage comme crime contre l’humanité, ne peut moralement éluder cette dette historique.
Dès lors, il est du devoir des gouvernants haïtiens de porter cette cause devant la scène internationale, en adoptant une diplomatie proactive, panafricaniste et solidaire. Car Haïti, seule, ne pourra pas mener ce combat. Mais avec le réveil africain contre les héritages impérialistes, un moment historique s’offre à nous pour corriger cette injustice, rendre justice à nos aïeux, et inspirer les peuples opprimés du monde entier. Haïti, première République noire du monde, doit retrouver sa voix et montrer la voie.
Auteur : Joseph Wilfrid
Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

.png)

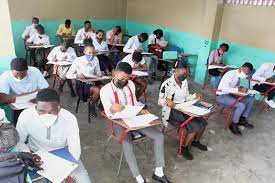

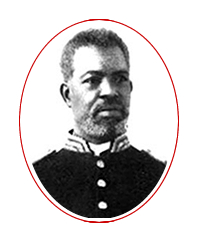


.png)
Commentaires
Publier un commentaire